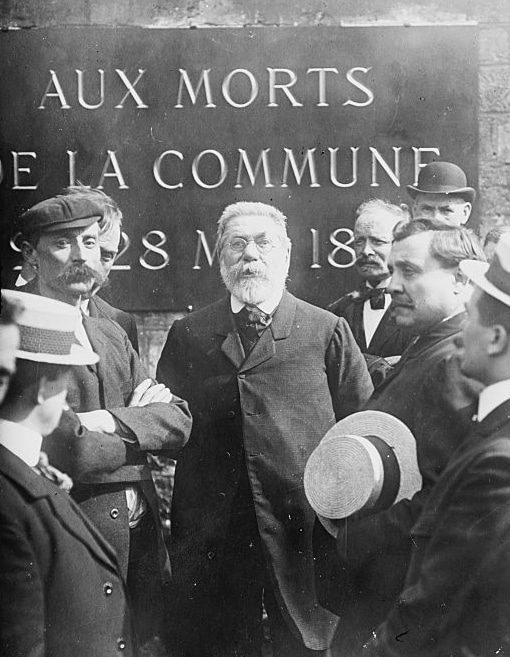L’AMI passe le cap des 800 numéros
Notre journal local l’AMI du 20e a fini son année 2023 avec la publication de son numéro 800. Au point d’en avoir fait sa « une ». Ce mensuel vendu en kiosque dans notre arrondissement est le plus ancien journal local de la région parisienne. Créé avant 1939, il a survécu à la guerre puis à la « boboïsation » de nos quartiers.

Numéro 1 de l’AMI de Ménilmontant, novembre 1945 – PG
À l’origine, un bulletin devenu journal
Avant la deuxième guerre mondiale, la paroisse de Notre Dame de la Croix de Ménilmontant publiait son bulletin sous le titre de l’Ami de Ménilmontant, bulletin qui va se saborder en juin 1940 après avoir publié 107 numéros. Il reparaît en novembre 1945, une nouvelle aventure animée par l’abbé Meuillet et un militant chrétien, Jean Simon.
Le changement est marqué sous forme d’un numéro 1, et il devient à la fois un journal chrétien comme l’indique le sous-titre « Courrier de la Chrétienté Paroissiale », journal militant et journal d’informations locales :
-
Un journal chrétien
Comme l’exprime l’éditorial du numéro 1 écrit après-guerre par l’abbé Meuillet, il s’agit d’abord d’un journal chrétien :
Dans le quartier, chaque jour ou presque un enterrement […….]. L’administration dira du disparu : « il est décédé ». Le concierge dira autour d’elle, rondement : « il est mort », le voyou gouailleur : « crevé », l’église elle dira : « le défunt »[…….] Pour nous chrétiens, la mort n’est pas le trou noir sans espérance. Ce n’est pas le néant. C’est la porte mystérieuse qui donne sur la vie éternelle.
-
Un journal militant
L’Ami de Ménilmontant s’engage aussi dans les actions locales. Le 20e est un quartier très populaire où les taudis sont nombreux après-guerre, les personnes âgées livrées à elles-mêmes et le logement précaire. Le journal informe et lance des actions de solidarité pour récolter charbon, nourriture, vêtements. Il aborde les problèmes de santé, de travail. Il enquête sur les maladies infantiles dans le 20e. On trouve également dans le journal une rubrique dédiée aux personnes en grande difficulté à aider dans le 20e. De nombreux jeunes travailleurs chrétiens bénévoles, souvent membres de la CFTC, vont participer à ces actions solidaires.
-
Un journal d’informations locales
Le journal s’ouvre aux actualités du quartier pouvant intéresser les habitants.
Et puis en mai 1947, la paroisse de Charonne rejoint l’équipe et le journal devient « L’Ami de Ménilmontant et de Charonne », avec comme sous-titre « courrier de la chrétienté du 20e ».

Jean Simon et Jean Vanballinghem, parmi les fondateurs de l’AMI en 1945 – PG
Dernier changement de titre : L’AMI du 20e
L’année suivante, l’administration du journal déménage et toutes les paroisses de l’arrondissement rejoignent le journal. Le titre change et devient en 1948 « l’Ami du 20e » avec comme sous-titre « Journal chrétien d’information locale ».
Ce titre ne changera plus, mais son sous-titre est aujourd’hui devenu « Journal d’informations locales, culturelles et chrétiennes ».
Outre les informations locales et paroissiales, le journal continue des actions de solidarité comme les « brouettes de l’Ami » pour récolter et distribuer aux personnes âgées dans le besoin des vêtements, du charbon et des biens alimentaires.
Son action sociale menée par de jeunes chrétiens bénévoles durera près de 10 ans; par exemple, en mars 1955, il promeut une campagne pour aider les enfants à partir en vacances. L’action religieuse reste aussi très présente, par exemple, en novembre 1960, le journal lance une souscription pour financer le voyage de malades à Lourdes.
La crise financière de l’AMI en 1990
Progressivement, le quartier s’embourgeoise et les actions sociales mobilisent beaucoup moins les lecteurs, au point que celles-ci seront progressivement réduites : les lecteurs ont tendance à s’intéresser davantage aux problèmes de propreté et de sécurité, moins à l’aide aux plus démunis.
Le journal lui-même entre dans de grandes difficultés financières en 1990, et doit en conséquence réduire le nombre de pages. En réponse à ces difficultés, une souscription est lancée en septembre 1991 et permettra de réunir les fonds nécessaires à la survie et à la relance du journal.

Une du numéro 800 de l’Ami du 20e-PHD
L’AMI du 20e d’aujourd’hui
Issu d’un bulletin paroissial et du mouvement ouvrier chrétien, le journal conserve une relation forte avec les paroisses du 20e et trois pages restent consacrées à la vie religieuse.
Le journal informe de tous les grands et petits évènements du quartier, en particulier ceux concernant les travaux d’aménagement et de transport. Il dispose de représentants dans les conseils de quartier dont il relate régulièrement l’activité. Plusieurs pages sont dédiées à la vie culturelle. Quant à la page « histoire », elle est rédigée par un membre de l’AHAV et expose chaque mois un sujet lié au 20e : il peut s’agir d’un lieu, un évènement ou une personne.
L’an prochain l’Ami fêtera ses 80 ans. Souhaitons-lui longue vie !
L’AMI passe le cap des 800 numéros